



 |
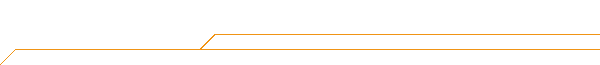 |
|||
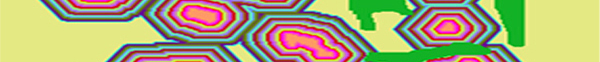 |
||||
| Accueil > Recherches en Ligne > Modélisations et simulations spatiales appliquées à l'aménagement et à la géoprospective |
||||
|
Organisation spatiale urbaine et desserte autoroutière Laurent Chapelon
Résumé Améliorer l’accès des territoires enclavés aux grandes infrastructures de transport et plus particulièrement aux échangeurs autoroutiers est un enjeu fondamental des politiques d’aménagement du territoire à l’échelle nationale. Cela implique de privilégier une approche donnant une plus grande place à l’équité spatiale plutôt que de rechercher systématiquement la seule efficacité économique des projets. Une démarche de planification axée sur une conception égalitaire de l’espace considère l’accessibilité comme le facteur principal de décision alors qu’une démarche visant à privilégier l’efficacité économique accorde peu d'intérêt au critère gains de temps, dans une évaluation de projets de type « analyse coûts – avantages ». La première démarche conduit à un maillage régulier du territoire alors que la seconde est à l’origine d’une organisation radiale des réseaux de transport privilégiant un nombre limité de couloirs performants dans lesquels se concentrent la majorité des échanges. En France, le réseau autoroutier en est un bon exemple. La structure arborescente centrée sur Paris, qui a prévalu jusqu’au milieu des années 80, a évolué progressivement vers une organisation de plus en plus maillée favorisant les relations transversales. Actuellement, les projets justifiés par des objectifs de désenclavement territorial et donc d’équité spatiale trouvent un terreau plus favorable à leur concrétisation. Deux questions principales se posent lorsqu’on étudie la qualité de la desserte autoroutière d’un territoire :
Afin de répondre à ces questions, une méthode d’analyse spécifique a été développée et appliquée aux cinq départements de la région Languedoc-Roussillon. Les résultats obtenus ont permis de dégager des priorités en matière d’investissements routiers à l’échelle régionale. L’originalité de la démarche adoptée ici tient dans la combinaison de deux approches contradictoires ; la desserte du plus grand nombre au nom de l’efficacité économique et le rééquilibrage territorial au nom de l’équité spatiale. Carte 1 : Dynamiques démographiques des villes du Languedoc-Roussillon
Carte 2 : Principales infrastructures routières du Languedoc-Roussillon
Méthodologie L’indicateur de qualité de desserte retenu pour l’analyse est le temps d’accès routier à l’échangeur autoroutier le plus proche. Il a été calculé pour chacune des 221 communes de plus de 2 000habitants du Languedoc-Roussillon (INSEE-RGP, 1999). Le réseau routier est modélisé par un graphe valué décrit en machine sous forme alphanumérique (logiciel MAP, A. L’Hostis 1993/2004, http://mapnod.free.fr). Les temps de parcours sont obtenus par recherche d’itinéraires optimaux (algorithme de Floyd) dans le graphe précédent (logiciel NOD, L. Chapelon 1993-2004, http://mapnod.free.fr). Ils sont ensuite confrontés pour analyse :
Une distinction par département permet d’affiner l’analyse, de dégager des disparités de desserte et ainsi de proposer des correctifs au nom de l’équité spatiale. Carte3 : Modélisation du réseau routier du Languedoc-Roussillon
Principaux résultats Les résultats obtenus sont largement positifs puisque 87% des habitants des communes de plus de 2 000 habitants en Languedoc-Roussillon sont situés à moins de 20 minutes d’un échangeur autoroutier. Figure 1: Qualité de la desserte autoroutière en Languedoc-Roussillon
A l’exception de Mende et d’Alès, toutes les villes de plus de 10 000 habitants sont localisées sous le seuil des 30 minutes. Ces résultats traduisent le haut niveau de concentration de population à proximité plus ou moins immédiate des grands axes de communication et donc l’excellente adéquation entre la desserte autoroutière et l’organisation spatiale urbaine de la région. L’efficacité économique a été ici clairement privilégiée lors du choix des tracés d’infrastructures. L’étude a également montré que, dans un contexte régional à forte croissance démographique, les communes ayant doublé leur population depuis 1975 sont toutes localiseés à moins de 20 minutes d’un échangeur autoroutier. Figure 2 : Croissance relative de la population des villes du Languedoc-Roussillon entre 1975 et 1999
En dessous de ce seuil d’accessibilité la quasi-totalité des communes croissent. Seules Perpignan, Béziers, Pézenas, Lodève et Saint-Chély-d’Apcher ont une évolution négative en raison notamment de l’attractivité de leurs communes périphériques, lesquelles captent l’essentiel de la croissance. Au-delà de 20 minutes les taux de croissance se répartissent autour de zéro. Les communes qui présentent les taux les plus faibles sont toutes localisées à plus de 50 minutes d’un échangeur autoroutier. Il y a, là encore, une bonne adéquation entre la localisation des pôles à forte croissance démographique et la qualité de la desserte autoroutière. En d’autres termes, les villes les plus dynamiques sont particulièrement bien desservies par les grands axes de communication. Les tracés d’infrastructures en s’inscrivant dans les grands couloirs de peuplement, propices au développement économique et aux échanges renforcent l’enclavement des communes rurales de l’arrière-pays. Les priorités en matière d’investissements en infrastructures routières concernent l’achèvement du raccordement à 2 fois 2 voies du bassin économique d’Alès à l’A9 via une nouvelle rocade à l’Ouest de Nîmes, ainsi que l’amélioration de la RN88 entre Mende et l’A75.
|
||||