



 |
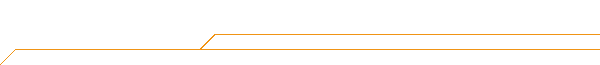 |
||||||||||||
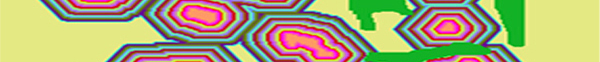 |
|||||||||||||
| Accueil > Recherches en Ligne > Modélisations et simulations spatiales appliquées à l'aménagement et à la géoprospective |
|||||||||||||
|
Modélisation spatio-morphologique de l'urbanisation Christine Voiron-Canicio
Résumé La contribution présente un exemple de démarche de modélisation spatiale appliquée à la géoprospective territoriale qui a pour but de modéliser la diffusion future du bâti dans un espace convoité, le sous-ensemble littoral languedocien. Le modèle est hypothético-déductif, il repose sur l’hypothèse qu’il existe des règles générales de diffusion du bâti, indépendantes des réglementations des documents d’urbanisme, qui rendent compte de la majeure partie du processus de diffusion. La démarche modélisatrice se décompose en trois étapes.
Présentation de la démarche A. Recherche des modalités de diffusion du bâti entre 1960 et 1990 De manière générale, l’urbanisation progresse selon 3 processus distincts qui conjuguent leurs effets :
Ces trois modalités de diffusion sont très inégalement représentées au cours des 2 périodes d'étude 1960-1977 et 1977-1990.
B. Les étapes de la modélisation spatio-morphologique du bâti La modélisation spatiale de l’urbanisation et la détection des lignes directrices de la diffusion du bâti ne sont réalisées que par traitements d’image à l’aide d’opérateurs de morphologie mathématique. Les règles de diffusion introduites dans le modèle découlent de l’étude des modalités de diffusion observées entre 1960 et 1990 : diffusion s’effectuant d'une part autour des espaces déjà bâtis et d'autre part, dans des directions privilégiées variant selon les périodes d'étude. Le modèle de base repose sur les règles de base suivantes :
Première simulation : diffusion uniquement produites par des fermetures géodésiques La transformation morphologique de la fermeture s’effectue en deux temps. Tout d’abord, les composantes bâties sont dilatées de un pixel puis, l’image résultat est érodée d’une taille équivalente. Cette séquence a pour effet de réunir les surfaces bâties les proches, de combler les concavités des contours et de rattacher les aires les unes aux autres par comblement des vides interstitiels.
Deux manières complémentaires de valider le modèle spatio-morphologique sont proposées. 1) La comparaison de l'extension du bâti observée et simulée. Cette comparaison peut d'abord s'effectuer visuellement. Les surfaces bâties estimées par le modèle (A) sont intersectées avec les surfaces observées (B). Le résultat permet de repérer l’emplacement des zones de concordance. Comparaison des bâtis simulé et observé Le degré de concordance des deux squelettes peut être aussi visualisé et mesuré au moyen de la distance de Haussdorff (Voiron-Canicio, 1995). Cette mesure des écarts entre les deux tracés correspond à la distance à combler pour que les deux squelettes se recouvrent totalement.
Comparaison des 2 squelettes
Remarques : La diffusion par connexion entre les petits éléments du bâti est surestimée par le modèle. Inversement, la croissance auréolaire des gros bourgs est sous-estimée. L'axe central Montpellier-Carnon et la bande littorale ont connu une croissance du bâti plus forte que le reste du sous-ensemble littoral. Cette différenciation n'est pas prise en compte par le modèle.
2) Le calcul du coefficient de similarité "simil" simil(A,B) = aire intersection (A,B) / aire union (A,B)
on a d(A,B) = aire union (A,B) - aire intersection (A,B) = [1- simil(A,B)] x aire union (A,B).
Simil est relié à la distance d, mais à sa différence, il ne dépend pas de la taille des images. A noter que simil(A,B) est différent de simil(A c,B c) . Enfin il vaut 0 quand la distance d est maximum, et 1 quand elle est nulle (deux objets identiques sont parfaitement similaires, et ils ont une distance nulle).
3) Deuxième simulation : modification du processus de diffusion Pour rendre compte de la croissance auréolaire observée dans les gros bourgs et de la différenciation spatiale entre la bande côtière, l'axe central et les gros bourgs, d'un côté, et le reste du sous-ensemble, de l'autre, le processus de diffusion spatio-morphologique s'effectue désormais en 2 temps :
Comparaison des bâtis simulé et observé
|
|||||||||||||